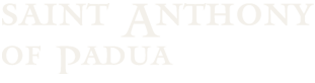Le saint François de Madère
Madère, ce rocher verdoyant perdu dans l’Atlantique, au large du Maroc, ne se laisse pas facilement aborder, aujourd’hui comme hier. C’est en surmontant les tempêtes que les caravelles des navigateurs portugais ont découvert l’archipel de Madère en 1418, et l’année suivante l’île éponyme. Aujourd’hui, on y accède par les airs mais l’atterrissage donne souvent des sueurs froides aux passagers, la piste de l’aéroport de Funchal étant réputée difficile d’accès. Parfois même l’avion est contraint de faire demi-tour, je l’ai vérifié !
En 1419, une première messe est célébrée sur l’île (à Machico) par des franciscains, et en 1514, le premier diocèse de « l’empire portugais » est érigé à Funchal ; en 1551, ce diocèse devient suffragant du patriarcat de Lisbonne. Sur le plan économique, Madère connaît alors une certaine opulence grâce à la canne à sucre (cultivée par des esclaves noirs) et au commerce avec les Flandres. Funchal se dote de nombreux couvents (dont le monastère Sainte-Claire, intégralement conservé), et d’un collège de Jésuites, fondé en 1570 et lui aussi intact.
Non loin de la cathédrale, l’ancien palais épiscopal (et sa chapelle dédiée à saint Louis de Toulouse) est devenu aujourd’hui le Musée d’art sacré – où j’entre sans trop savoir ce qui m’attend.
Étonnant François d’Assise
Surprise : par ses collections d’orfèvrerie, de sculptures et de peintures, le musée de Funchal égalise ou surpasse de grands musées provinciaux français. Cinq siècles de vie religieuse et liturgique portugaises (mais aussi flamandes) y sont présentés. L’iconographie franciscaine figure en bonne place avec notamment plusieurs représentations de sainte Élisabeth du Portugal (la reine fondatrice du monastère de Coimbra), de sainte Claire, des martyrs franciscains du Maroc et, bien entendu, de saint Antoine (dont un volet de triptyque attribué au peintre anversois, Jean Provost, vers 1525).
Mais c’est un étonnant saint François, dans l’une des premières salles du musée, qui retient aussitôt mon attention. Vous l’avez sous vos yeux. Assurément, vous en conviendrez avec moi, sur le plan stylistique, ce tableau n’est pas un chef-d’œuvre absolu. Cette peinture, marquée par le « ténébrisme », presque complètement dans les tons ocres, ne convainc pas vraiment. Son auteur est inconnu – un peintre portugais du XVIIe siècle – et on sait uniquement que cette toile provient de l’église des Jésuites de Funchal. Mais le sujet interroge. Sur le cartel apposé dans le musée, il est indiqué : « Saint François d’Assise protégeant la hiérarchie de l’Église ». Bigre !
Enquête sur un tableau
Aucun doute, le personnage central est bien François d’Assise. Les stigmates (mains et côté) l’attestent. La bure est franciscaine, sans qu’il soit possible de préciser davantage. Sans doute l’habit de frères réformés, car François est pieds nus, et barbu. Le manteau ressemble à celui que l’on voit sur les représentations de saint Pierre d’Alcantara.
Arrêtons-nous sur l’attitude de François, et précisément sur ses bras étendus, en forme de croix. À mon sens, c’est une allusion à un célèbre épisode de la vie de saint Antoine. La Rigaldina (une vie ancienne d’Antoine), rapporte en effet ce qui « se passa une fois en Provence, à Arles, alors que les frères étaient réunis en chapitre provincial. Comme Antoine y prêchait, avec une piété suave, sur le thème de l’écriteau de la croix : “Jésus de Nazareth, roi des Juifs”, son très bienheureux père François, encore vivant, mais se trouvant loin de là en Italie, apparut pour lui rendre un fidèle témoignage, à la porte de la salle du chapitre, élevé en l’air, les bras étendus en croix, et bénissant les frères. Il semblait convenable et opportun que François vînt apporter son témoignage à Antoine qui, depuis les premiers jours de son entrée dans l’Ordre, avait désiré et désirait encore si ardemment le supplice de la croix, et qui dévoilait à ce moment les mystères de la Passion. »
Les artistes médiévaux qui ont illustré ce passage représentent toujours François les bras en croix. Le François du tableau de Funchal est un François crucifié, un alter Christus, un autre Christ.
Le manteau protecteur
Sur ce tableau, le manteau de François se prolonge et il est soutenu de chaque côté par deux anges, qui en couvrent très nettement les personnes agenouillées. Ici, la référence est limpide. François est représenté à l’image des vierges au manteau (ou vierge de miséricorde) assez fréquentes dans la peinture et la sculpture médiévales (moins souvent après). Marie, figure maternelle, protège l’humanité et intercède pour elle. Chef-d’œuvre du genre, la Madone des Franciscains de Duccio (vers 1300) de la Pinacothèque de Sienne.
Avec le tableau de Funchal, François conjugue ainsi la figure masculine et salvatrice du Crucifié, à celle, féminine et protectrice, de Marie. C’est exceptionnel ! Je ne connais aucun autre tableau de ce type – mais puissent les lecteurs me détromper ! En revanche, il existe des représentations de sainte Claire au manteau, en particulier celle qui a été réalisée au XVIIe siècle pour l’Ave Maria de Paris et qui se trouve aujourd’hui au monastère de Montbrison. Claire protège la nombreuse communauté parisienne (novices comprises), et, remarquez-le, les sœurs sont toutes pieds nus – ce que les textes nous disent par ailleurs.
Pourquoi tant de tiares ?
S’agissant du tableau de Funchal, il reste à savoir qui bénéficie de la protection du manteau. Beaucoup d’hommes d’Église, certes. Au moins quatre portent des tiares. Quatre papes ? Il se trouve que les patriarches de Lisbonne ont eu longtemps le droit de porter la tiare sur leurs armoiries et lors des grandes cérémonies religieuses. On peut donc penser que l’artiste a voulu figurer l’Église du Portugal, avec des patriarches de Lisbonne, un cardinal, un évêque mitré (celui de Funchal ?), un roi, une reine (sur la droite), et enfin, sur la gauche, un homme en noir – sans doute jésuite et commanditaire du tableau.
Cette peinture, qui n’est pas d’origine franciscaine, témoigne sans doute de la dévotion d’un jésuite à l’égard de saint François, peut-être son saint patron. C’est une œuvre relativement médiocre sur le plan esthétique, mais riche de réflexion sur François d’Assise.
Merci au personnel du Musée d’art sacré de Funchal pour sa serviabilité et sa maîtrise de la langue française. http://masf.pt