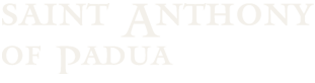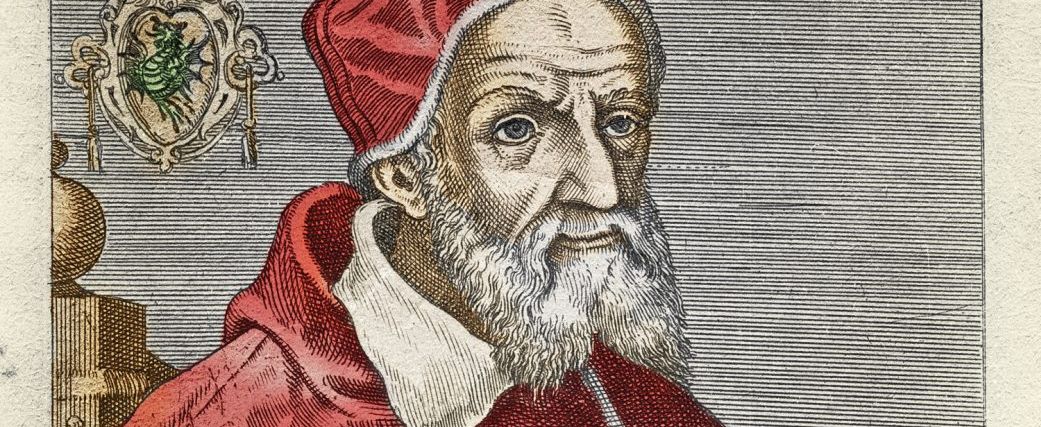L’histoire du calendrier grégorien
Le calendrier rythme notre vie quotidienne : fêtes religieuses, anniversaires ou simples rendez-vous. Pourtant, peu savent que notre calendrier actuel est né d’un profond souci de foi et de précision scientifique. C’est l’Église et plus précisément le pape qui est à l’origine de cette réforme du temps. Ugo Boncompagni, plus connu sous le nom de Grégoire XIII, était passionné par les sciences. Soucieux de concilier la foi et la raison, il encourage l’éducation et fonde la première université pontificale. Elle a pris le nom d’université Grégorienne. Toutefois, sa plus grande réalisation demeure la création d’un nouveau calendrier, le calendrier grégorien.
Une salle d’astronomie au Vatican
Avant le calendrier grégorien, l’Occident utilisait le calendrier julien instauré par Jules César en 46 av. J.-C. Une année comptait 365 jours, avec un jour supplémentaire tous les quatre ans, les fameuses années bissextiles. Or, l’année solaire réelle, c’est-à-dire le temps que met la terre à faire un tour complet autour du soleil, dure environ 365,2422 jours. L’écart semble dérisoire, mais il s’amplifie au cours du temps jusqu’à devenir des jours entiers. Le pape s’inquiète de l’influence de ce décalage sur le calendrier liturgique. La date de Pâques est fixée, depuis le concile de Nicée, en fonction de l’équinoxe de printemps. À ce rythme, Pâques finirait par être célébrée en plein été ! Pour éviter cela, Grégoire XIII fait construire en 1579 la tour des vents. Haute de 73 mètres, elle constitue un des points culminants de la cité du Vatican. En son cœur se trouve la salle de la méridienne. Tracée d’après les calculs de l’astronome dominicain Ignazio Danti, la méridienne est une sorte de cadran solaire qui permet de déterminer l’heure de midi. Au milieu du jour, à l’équinoxe de printemps, le rayon doit tomber sur une ligne spécifique. Après un premier test, on observe que l’équinoxe a dix jours d’avance sur la date officielle. L’année calendaire dépasse donc l’année solaire. Le pape demande alors à ses scientifiques de faire des propositions pour remédier à ce décalage. Ils proposent une réforme. Le Saint-Siège la fait connaître dans la bulle Inter gravissimas.
Remettre les pendules à l’heure
La réforme du calendrier consiste à supprimer certaines années bissextiles. Une année divisible par 100 n’est pas bissextile, sauf si elle est divisible par 400. D’autre part, pour rattraper le retard pris sur l’année solaire, le pape supprime dix jours dans l’année en cours. On passe soudain du 4 au 15 octobre 1582 ! Fait surprenant, Thérèse d’Avila meurt durant cette longue nuit. Enfin, l’année débute officiellement le 1er janvier au lieu du 25 mars, comme c’était devenu la coutume dans certains pays.
La réforme est adoptée au fur et à mesure par les États catholiques. Elle suscite en revanche des résistances dans les pays majoritairement protestants. L’Angleterre n’adopte le calendrier grégorien qu’en 1752. Les dix jours supprimés au cours de cette année provoquèrent la colère du peuple et des émeutes. La population craignait que le gouvernement lui retire onze jours de salaire. Chez les Helvètes, la situation est complexe. Les cantons catholiques souhaitent adopter le nouveau calendrier alors que les cantons réformés s’y opposent fermement. La discorde ne prend fin qu’en 1812.
Jusqu’à quand ?
Malgré sa précision, le calendrier grégorien n’a pas résolu toutes les questions. L’un des points les plus sensibles reste la date de Pâques, qui continue de varier selon les traditions chrétiennes. Tandis que les Églises catholiques et protestantes suivent le calendrier grégorien, les Églises orthodoxes se réfèrent encore au calendrier julien. La fête centrale de la foi chrétienne n’est donc pas célébrée à l’unisson par tous les chrétiens. Plusieurs papes ont tendu la main pour tenter de s’accorder. Paul VI, dans l’élan du Concile Vatican II, avait évoqué la possibilité d’une date fixe pour Pâques. Jean-Paul II avait soutenu une proposition œcuménique fondée sur les critères du Concile de Nicée. En 2015, le pape François déclarait : « Je suis prêt à fixer la date de Pâques. Dites-moi seulement quand ». Un geste fort, accueilli avec bienveillance par plusieurs responsables orthodoxes, mais qui n’a pas encore abouti à un accord. Certains scientifiques proposent un calendrier perpétuel, affranchi des traditions religieuses. Ces projets, aussi rationnels soient-ils, peinent à convaincre. Ils retireraient toute symbolique au calendrier actuel et au temps.