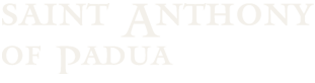En chemin avec Antoine de Montbrison à Chambéry
Allez, frère Antoine, encore un effort ! Après avoir franchi les Monts du Forez, il faudra grimper les Monts du Lyonnais pour après descendre sur Lyon.
Montbrison, 21 juillet
Mais en attendant, une étape s’impose chez les clarisses de Montbrison. 525 ans que le monastère a été fondé par Pierre d’Urfé, et les sœurs sont toujours là, fidèles au poste confié par Dieu. À l’origine ce sont des filles de sainte Colette, des « Colettines », venant du Puy, de Chambéry, d’Aigueperse, de Genève et de Moulins, qui sont arrivées à Montbrison. Les Colettines ont toujours eu la réputation d’être accueillantes. Au XVIIe siècle, un franciscain, Jacques Fodéré, toujours par monts et par vaux, témoignait de la qualité de l’accueil reçu chez les clarisses colettines de Seurre (Côte-d’Or) : « Quant à la charité, elles l’ont toujours pratiqué à l’endroit des Religieux passants, qu’aussitôt qu’ils sont arrivés, les sœurs portières donnent de l’eau bouillie avec de bonnes herbes, pour leur laver les pieds, et du beau linge blanc pour les essuyer ». Alors, chères sœurs de Montbrison, prêtes à soigner nos ampoules ?
Et puis à Montbrison, frère Antoine, tu pourras toucher du doigt ce que l’on entend par « famille franciscaine » : en effet, à la Révolution, les Clarisses ont perdu leur monastère, qui a été détruit. La communauté a pourtant survécu, et, en 1821, elle a pu récupérer l’ancien couvent des Capucins, fondé en 1609. Dédiée à Notre-Dame des Anges, comme la Portioncule, l’église conventuelle a conservé son allure capucine et elle convient très bien aux Clarisses. Entre frères et sœurs d’une même famille, on peut se prêter nos maisons, cela ne pose aucun problème.
Lyon, 26 juillet-11 août
Bienvenue à Lyon, capitale des Gaules, et presque 2 000 ans d’histoire chrétienne. Cette longue pause, cher Antoine, va te permettre de réparer tes sandales, mais aussi de goûter à la gastronomie locale (ce saucisson !) et de faire connaissance avec tes amis lyonnais de toutes les époques. Sais-tu qu’en octobre 1226 – François vient de mourir –, tes frères sont déjà présents à Lyon : quelqu’un leur lègue en effet 20 livres (monnaie de l’époque) « pour l’achat de vêtements ou pour les ornements de l’église ou pour l’amélioration des bâtiments ». Je me plais à imaginer qu’il y a 8 siècles, tu as pu les rencontrer en rentrant sur Padoue.
Ici, la grande figure franciscaine, désolé Antoine, ce n’est pas toi, mais Bonaventure. En 1274, le théologien franciscain, créé cardinal l’année précédente, est venu travailler à l’unité des chrétiens au concile réuni à Lyon, mais il y a trouvé la mort. Sa tombe, dans l’actuelle église Saint-Bonaventure, a été détruite en 1562 par les protestants, et la presque totalité des reliques du saint franciscain a disparu dans cette tragédie. Mais les Lyonnais aiment toujours venir ici s’inspirer de sa sainteté. Ils méditent devant une célèbre tapisserie du XVIIIe siècle qui montre Bonaventure faisant la vaisselle et laissant « poireauter » les envoyés du pape venus lui apporter son chapeau de cardinal. Une sorte d’icône de la vie franciscaine !
Réparées les sandales ? Alors, suis-moi frère Antoine. Montons d’abord à Fourvière, la colline « de ceux qui prient ». Au passage, faisons mémoire des Capucins et des Récollets, des religieux qui ont joué un grand rôle dans la vie spirituelle des Lyonnais. Les Capucins, présents depuis 1575, introduisent la prière des « quarante heures », l’ancêtre de nos nuits d’adoration. Quant aux Récollets, le 24 décembre 1622, ils plantent la croix de leur futur couvent près de la montée Saint-Barthélemy, en présence de François de Sales et de Marie de Médicis.
Fourvière. Ici, tu aurais pu rencontrer Jean-Marie Vianney, tertiaire franciscain, venu souvent d’Ars à pied (30 km) pour célébrer la messe. Le saint curé d’Ars y a même emmené toute sa paroisse, en 1823. Il a été canonisé il y a tout juste un siècle, en 1925.
Autre colline lyonnaise, la Croix-Rousse. À mi-hauteur, au n°6 de la rue des capucins, tu verras les vestiges du cloître du deuxième couvent des capucins lyonnais. Pour avoir refusé de prêter les serments révolutionnaires, Jean-Baptiste Loir – un frère lyonnais qui a passé de longues années dans ce couvent – est déporté, et retrouvé mort, à genoux, le 19 mai 1794, sur l’un des « pontons » (sorte de camp de concentration flottant) du port de Rochefort. Il a été béatifié en 1995.
Descendons, et nous voici maintenant à la Guillotière, un quartier de Lyon resté populaire. C’est ici qu’a œuvré Antoine Chevrier (1826-1879), tertiaire franciscain, et fondateur du Prado, une compagnie de prêtres au service des plus pauvres. Mort à 53 ans, il déclarait : « Il vaut mieux vivre dix ans de moins en travaillant pour Dieu que de vivre dix ans de plus en ne faisant rien ». Dans la chapelle du Prado (9, rue père Chevrier), qui a gardé sa pauvreté des origines, la tombe du père est toujours là, sous les pas de ceux qui vont communier.
11 août. Sainte Claire oblige, un petit passage rue Sala (près de la place Bellecour) s’impose. En 1598, des colettines venues de Bourg-en-Bresse avaient fondé un monastère dans le quartier d’Ainay. Après la Révolution, elles déménagent rue Sala et elles y demeurent jusqu’en 1952. Aujourd’hui, c’est une maison de formation jésuite. Frère Antoine, tu n’as rien contre les Jésuites, au moins ? Dans la chapelle (reconnaissable de la rue à ses conformités franciscaines), le 18 juin 1944, Joseph Folliet, le fondateur des Compagnons de Saint-François, a fait profession dans le Tiers-Ordre.
Chambéry, 17-18 août
Traversée des Alpes. Attention, ça va grimper ! Mais toujours de belles étapes franciscaines en perspective. À Chambéry, direction la cathédrale qui n’est autre que l’ancienne église des Frères Mineurs.
Oui, tu vois Antoine, les frères, en vrais mineurs, doivent parfois céder la place. Implantés dès le XIIIe siècle, très appréciés par la population, les Franciscains Conventuels avaient reconstruit leur église aux XVe et XVIe siècles. Le Saint-Suaire de Turin y a parfois été exposé. Mais lorsque Chambéry devient un évêché, en 1779, on ne trouve pas mieux que de déloger les frères pour transformer leur église en cathédrale. Et l’actuel Musée Savoisien, juste à côté, avec son beau cloître… c’est l’ancien couvent. Tu n’en veux pas aux Savoyards, cher frère Antoine ? À l’époque, ils étaient peut-être davantage disciples de Jean-Jacques Rousseau que de François d’Assise…
À suivre…