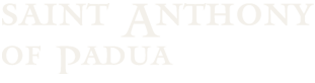De Turin au Lac de Garde, avec Antoine
Suse, Sacra di San Michele, Rivoli, pas de doute frère Antoine, nous voici en Piémont, et donc en Italie, et nous sentons la différence. Je m’explique : parmi les provinces franciscaines, il a longtemps existé une distinction très nette entre celles dites cismontaines (c’est-à-dire de ce côté-ci des monts, sous-entendu des Alpes) et celles dites ultramontaines (au-delà des Alpes). Or, cette différenciation est toujours perceptible aujourd’hui. En France, ils sont nombreux ceux qui n’ont strictement jamais entendu parler de François ; en Italie, c’est plus rare, y compris dans les jeunes générations, tellement François et les saints franciscains imprègnent la culture, l’histoire et les traditions. Ici, pas un couvent ancien qui ne revendique sa fondation par François ou ses premiers compagnons, pas une cité qui ne dispose de son église franciscaine, par un chemin qui ne porte la marque des frères. Certes, la sécularisation progresse aussi en Italie, et la famille franciscaine y est moins nombreuse – il n’empêche, le contraste avec la situation française continue de sauter aux yeux.
Turin, le Mont des Capucins
29 août, nous voici à Turin, la grande cité italienne de l’industrie automobile. Mais Turin a aussi son histoire franciscaine, symbolisée par une colline de verdure dominant la plaine du Pô, il Monte dei Cappuccini, le Mont des Capucins. Son histoire commence bien avant toi, Antoine, au XIe siècle. À cette époque, ce n’est encore que la Batista, la forteresse qui défend la ville. Une petite chapelle dédiée à sainte Marie y a été édifiée. En 1581, le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, fait cadeau de la colline aux frères mineurs capucins, un peu comme en 1213, le comte Roland de Chiusi avait offert l’Alverne à saint François. Mais l’endroit, trop près de la ville, n’est guère propice à une vie d’ermitage. Le duc de Savoie va donc financer la construction d’un grand couvent, qui deviendra à terme le siège de la province capucine du Piémont. Commencée en 1584, l’église n’est achevée qu’en 1637. En forme de croix grecque, surmontée d’une coupole plusieurs fois remaniée, elle présente un aspect à la fois austère et solennel ; sa silhouette très originale, se découpant entre azur et verdure, est familière aux Turinois.
Très vite, le Mont des Capucins a occupé une place à part dans le paysage intellectuel et religieux de la ville. Dès 1596, les frères décident d’y établir une bibliothèque, et Charles-Emmanuel Ier fait don de 665 volumes, comprenant notamment l’ensemble de la bibliothèque personnelle du défunt évêque franciscain d’Asti, le célèbre prédicateur François Panigarole. Cette précieuse bibliothèque est aujourd’hui largement ouverte aux étudiants et aux chercheurs. Mais les capucins piémontais se font aussi les champions de la charité au temps des épidémies. En 1598, le premier gardien du couvent, Hilaire de Ceva, meurt vaincu par la contagion. Lors des grandes vagues de choléra (1831, 1854, 1865), les frères se dévouent sans relâche auprès des populations. Aujourd’hui encore, les Capucins cherchent à harmoniser leur vie de prière, d’étude et de solitude avec les besoins et les exigences des Turinois et Turinoises.
Parmi les saints religieux qui se sont succédé au Mont des Capucins, cher Antoine, j’aimerais te présenter Chérubin de Maurienne, l’ami de François de Sales et le génial maître d’œuvre de la reconquête spirituelle du Chablais par les catholiques, qui meurt au Mont le 23 octobre 1609, de retour d’un voyage à Rome. Mais aussi le bienheureux Ignace de Santhià (1686-1770), l’apôtre du Piémont, qui a passé les 25 dernières années de sa vie au Mont. Alors même qu’il ne peut plus quitter l’infirmerie du couvent, il n’a de cesse de soulager les pauvres et de recevoir les riches en confession. Et enfin, plus près de nous, le cardinal Guillaume Massaia (1809-1889), le grand missionnaire capucin des temps modernes, parti du Mont en 1846, pour rejoindre le pays auquel il a voué sa vie, l’Éthiopie.
Brescia
13 septembre, Brescia. L’histoire franciscaine de cette ville de Lombardie commence bien avant toi, cher Antoine. Selon une antique tradition, elle remonte à une rencontre entre François et Dominique qui se serait déroulée à Bergame. Par la suite, les deux saints auraient résidé quelques jours dans l’église San Giorgio de Brescia (une église romane « baroquisée », aujourd’hui désaffectée). Par ailleurs, Thomas de Celano nous apprend qu’au début de 1226, un « frère de Brescia », mû par une indiscrète curiosité, s’est rendu à Sienne, où se trouvait alors François, avec le désir de voir ses stigmates dont on commençait à entendre parler. En 1248, les frères disposent certainement d’une communauté à Brescia puisqu’ils s’emploient à rétablir la paix au sein d’une ville minée par des rivalités intestines. La population fait même le vœu au saint d’Assise de construire une église en son honneur pour que cesse cette guerre civile. De fait, un magnifique complexe conventuel est construit entre 1254 et 1265, et il nous est parvenu presque intact. San Francesco de Brescia est la première église à avoir été bâtie pour les frères en Lombardie. Frère Antoine, tu n’as jamais connu de constructions aussi spacieuses, mais je t’en prie, ne fronce pas les sourcils !
La Madonna del Frassino
15 septembre. Ici, Antoine, tu vas saisir à quel point en Italie les gens ont pu tisser des liens avec les frères. En 1510, près du village de Peschiera, sur les hauteurs verdoyantes du Lac de Garde, un paysan est sauvé d’une morsure de serpent par la Vierge qui lui apparaît au creux d’un arbre sous la forme d’une statuette de bois entourée d’un halo de lumière. Un sanctuaire voit le jour, et dès 1514, les villageois décident de demander aux frères mineurs de le desservir. Ceux-ci acceptent la proposition… et cinq siècles plus tard, ils sont toujours présents. Le 8 décembre 2014 – pour les 500 ans de leur arrivée – toute la population s’est rassemblée au sanctuaire avec la communauté des frères pour chanter un Te Deum en signe de gratitude pour tout ce qui s’est vécu au sanctuaire. Un nombre incalculable de frères s’est en effet dépensé pour développer la dévotion à Notre-Dame et pour diffuser la spiritualité franciscaine, à la fois en ce sanctuaire et tout autour du Lac de Garde.
Vérone, Belfiore, Lonigo, San Pancrazio, Praglia… et Padoue. Retour à la maison ! Merci pour ce bel été en ta compagnie, cher frère Antoine.